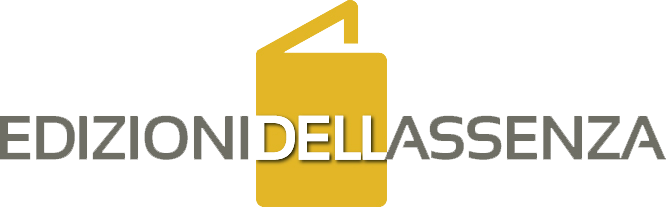LE BEAU FILS
PRÉFACE
“Bove fait partie de ces rares écrivains, très rares, qui ont véritablement créé un monde, un univers bien à eux, et lorsqu’on fait l’effort de pénétrer cet univers, on en est récompensé.” JEAN GAULMIER (1)
Emmanuel Bove, écrivain réservé comme peu, mort à l’âge de seulement quarante-sept ans, a écrit une stupéfiante quantité d’ouvrages. Or, pour la plupart de ceux-ci, je crois qu’on peut affirmer que lui seul pouvait les écrire : cette écriture apparemment simple, sinon modeste, et en réalité très surveillée ; ce regard aigu, parfois compatissant parfois impitoyable, visant la condition humaine ; cet humour amorti ; cette capacité à conférer immensité et mystère à la chose la plus petite, cachée ou ignorée ; certains procédés narratifs, parfois déroutants ; cette détermination nette à éviter la recherche d’effets et chaque tentative de flatter le lecteur... Tout cela n’appartient qu’à lui. Tomber sur Bove, c’est découvrir la singularité exemplaire d’un auteur.
Dans sa vie, pendant quelques années, Emmanuel Bobovnikoff (de son vrai nom) a connu une certaine notoriété. Découvert par Colette, qui publiera son premier roman Mes amis, il gagne le prestigieux prix Figuière et est très apprécié par Rilke, Gide, Max Jacob, Philippe Soupault, Maurice Utrillo et tant d’autres ; puis, lentement mais inexorablement, sa fortune commence à décliner, au point qu’en 1944 il lui est difficile de publier son beau roman Le piège − qui sera à la fin publié, mais passera inaperçu ; en 1945, l’auteur meurt.
À sa disparition suivit la disparition complète de ses œuvres, et cela pendant plus de trente ans. Et on se demande pourquoi. Peut-être cette disparition fut-elle déterminée par l’affirmation d’une littérature soi-disant engagée ? En effet, s’il est vrai que Bove a eu une orientation politique sérieuse et courageuse (il était antifasciste, faisait parti du Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes, et, malgré les sollicitations, refusa de publier durant l’occupation allemande), (2) il est également vrai que son œuvre ne présente ni prises de position idéologiques ni théories à caractère sociologique, ni, encore moins, ne propose de solutions. Une faute que, probablement, il a dû expier.
Il faut aussi ajouter que, même après les efforts déployés − à partir des années soixante-dix − par quelques écrivains (3) et éditeurs (4) avisés et sensibles, pour sortir de l’ombre l’œuvre de Bove, le vent de l’oubli, par intermittence, a recommencé à souffler sur celle-ci.
Peut-être parce que, tout bien considéré, l’idée que la littérature doit être porteuse de messages a la vie dure ? Peut-être parce que ses personnages, pour la plupart des êtres égarés et voués à l’échec, qui ont la consistance de l’ombre et qui ne semblent rien vouloir dire, déconcertent et perturbent notre monde agressivement proactif ? Peut-être pour d’autres raisons encore ?
Quoi qu’il en soit, son œuvre tend à disparaître et à réapparaître, à disparaître et à réapparaître, ce qui, par ailleurs, correspond parfaitement à l’homme qu’était Bove : “ […] Ses quelques rares amis avaient l’impression qu’il cherchait à se faire oublier, comme d’autres cherchaient à se faire connaître”. (5)
Aujourd’hui les Edizionidellassenza offrent aux lecteurs italiens l’opportunité de lire Le Beau-fils − l’une de ses œuvres les plus négligées.
Le Beau-fils a été publié en 1934. “C’est avec un très bon roman de maturité qu’Emmanuel Bove, après un silence de quatre années, fait sa rentrée littéraire”. C’est ainsi que le service de presse des éditions Bernard Grasset annonça sa publication. Malheureusement, le livre, comme l’auteur l’a écrit lui-même dans une lettre à son frère Léon, lui apporta plus un succès moral qu’un succès commercial. (6)
Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un roman central, complexe et à bien des égards énigmatique dans la production bovienne.
Pour commencer, disons qu’il s’agit de son œuvre la plus autobiographique, ce qui doit toutefois inciter à une extrême prudence et ne doit pas faire oublier la somme d’équivoques qu’une telle affirmation peut susciter. C’est l’auteur lui-même qui nous autorise − et parfois, pourrait-on dire, qui nous pousse − à la définir comme telle, tant il parsème l’œuvre, surtout dans la première partie, de dates et de faits qui coïncident avec des dates et des faits de son existence : il suffira de rappeler que, après quelques pages seulement, nous apprenons que Jean-Noël, le personnage principal, est né à la fin d’avril 1898, mois et année de naissance de l’auteur. Par ailleurs, la lecture de la biographie extrêmement fouillée de l’auteur écrite par Raymond Cousse et Jean-Luc Bitton, au titre magnifique de Emmanuel Bove. La vie comme une ombre, ne peut que nous confirmer le caractère fortement autobiographique du roman. En somme, Le Beau-fils fait penser qu’une certaine urgence, une frénésie d’expulsion de sa propre histoire, a poussé Bove à se mettre soi-même en scène.
Incontestablement, tout cela est suggestif et intéressant, ne serait-ce que parce qu’ici, plus clairement qu’ailleurs, il nous serait donné à découvrir les origines lointaines de certaines obsessions de l’auteur.
Je crois toutefois, je le répète, qu’il est important d’éviter certains risques, toujours présents quand on parle d’autobiographie. Celui, par exemple, de faire coïncider les personnages de l’ouvrage avec des personnes réelles. Ou de tomber dans la tentation de vouloir comprendre ou justifier l’auteur à travers les événements de sa vie. Bien sûr, un écrivain, c’est aussi son histoire, mais, si celle-ci parvient à laisser certaines traces spécifiques et inimitables dans son œuvre, cela se produit dans la mesure où il est, justement, un écrivain. Je veux dire que, fatalement, un écrivain est tel avant l’histoire.
Il convient en outre de souligner que, si d’un côté Bove semble vouloir nous orienter vers la piste autobiographique, d’un autre côté il cherche également à nous égarer et à faire naître le doute en nous, non pas tant à travers des omissions ou des déformations qu’en maintenant constamment une distance totale et aseptique par rapport à son matériau. En effet, Bove est ici ce qu’il est ailleurs : un impassible et implacable observateur et descripteur des mouvements psychologiques de ses personnages, du fonctionnement de la psyché, de son dysfonctionnement et de ses automatismes dramatiques, ce qu’il fait, d’autre part, sans aucun effort semble-t-il : il voit les mécanismes mentaux de ses personnages, comme un anatomiste voit dans le corps qu’il dissèque.
Il ne faut pas oublier non plus que Bove était clairement conscient de l’abîme qui sépare l’écriture et la vie, de l’impossibilité du langage d’atteindre des certitudes, et certainement conscient que “l’art est la magie délivrée du mensonge d’être vrai”, comme le dit Adorno. (7)
Enfin, pour conclure cette digression sur le caractère autobiographique de Le Beau-fils et en réaffirmer la nature problématique, je rapporterai quelques mots de Bove lui-même :
“Mes personnages ressemblent à toutes sortes de gens que j’ai connus, mais à aucun d’eux en particulier. [ … ] Si on copie ses personnages, on ne les crée pas, il n’y a pas de vie. Les modèles vivants ont un rôle à jouer, mais ils ne doivent fournir que les éléments de la création”. (8)
Et, en réponse à la requête de l’éditeur Lucien Kra de rédiger une note biographique pour la publication de Un soir chez Blutel : “J’avoue qu’ici mon trouble est un peu celui de l’acteur qui, oubliant tout d’un coup son rôle, est obligé d’inventer des répliques ou de s’excuser tant bien que mal auprès des spectateurs. Ce que me demande Lucien Kra est au-dessus de mes forces [...] pour mille raisons, dont la première est une pudeur qui m’empêche de raconter des histoires sur moi dont la plupart, d’ailleurs, seraient fausses. Il y aurait bien ma date de naissance qui serait exacte. Encore faudrait-il que mon humeur du moment ne me poussât pas à me rajeunir dans le but de passer pour un prodige ou à me vieillir pour donner plus de poids à mes livres. Qui saurait d’ailleurs résister au plaisir d’emplir sa biographie d’événements, de pensées basses, d’envie d’écrire à l’âge de huit ans, de jeunesse incomprise, d’études très brillantes ou très médiocres, de tentatives de suicide, d’actions d’éclat à la guerre, d’une blessure mortelle dont on a réchappée, d’une condamnation à mort dans un camp de prisonniers et de la grâce arrivant à la veille de l’exécution. Le plus sage, je crois, est de ne pas commencer”. (9)
Et, dans son article sur Maurice Betz : “Dans le roman surtout, rien n’est plus dangereux que la volonté de se montrer sincère. […] la sincérité […] ne s’y trouve en quelque sorte que par accroc, par accident, et malgré l’auteur”. (10)
Dans Le Beau-fils, la première chose qui saute aux yeux est la longueur inhabituelle du roman (plus de trois cents pages), Bove ayant toujours préféré la nouvelle ou le roman bref. La structure du roman étonne elle aussi : traditionnelle, au moins d’apparence, et avec une intrigue plutôt complexe, qui fourmille de noms propres de personnes, de villes, de banlieues et de rues − curieuse fracture avec ses œuvres précédentes, dont le dépouillement et la modernité explosive l’avaient conduit à la notoriété.
Et pourtant, à mesure que l’on avance dans la lecture, on se rend compte du caractère trompeur, sinon moqueur, de l’intrigue : rien d’autre que la glu dans laquelle se débat le malheureux Jean-Noël. Et, plus on avance, plus on comprend que, les caractéristiques inhabituelles mises à part, le livre reste un concentré de presque tous les thèmes et les obsessions de Bove.
Le jeune Jean-Noël porte les stigmates de nombreuses créatures d’Emmanuel Bove. Comme beaucoup d’entre elles, en effet, il est submergé par un désir démesuré d’amour et par une obstination maladroite et velléitaire à vouloir le satisfaire ; comme beaucoup d’entre elles, il est affligé d’une radicale inaptitude à déchiffrer ce qui l’entoure, raison pour laquelle les actes qui devraient le mener à la destination convoitée se retournent contre lui, sont des faux pas et le perdent − inéluctablement chaque soi-disant conquête finit par se révéler pure illusion.
On trouve dans Le Beau-fils presque tout l’éventail des possibles façons d’agir ou, devrait-on dire, de s’agiter, de grand nombre de ses personnages : Jean-Noël est tour à tour naïf, obtus, impitoyable, aveugle.
Bref, il est ce qu’à juste titre on a pu dire de nombreux protagonistes des romans et des histoires de Bove : un anti-héros. Mais, en même temps, ici comme ailleurs, le contraste entre l’énormité et la ténacité de la demande et l’inévitable échec, débouche, à plusieurs reprises, sur le sentiment du tragique.
Emmanuel Bove est un maître dans l’art de raconter la tragédie de ceux qui sont petits, marginaux ou même simplement ineptes.
La différence avec d’autres nouvelles et romans de l’auteur, c’est que dans Le Beau-fils le personnage principal ne doit pas aller à la recherche effrénée d’un ami, d’une femme, ou de n’importe quel être qui l’aime et qu’il puisse aimer ; son objet d’amour a un nom et un visage qui lui est bien connu : celui de Annie Villemur de Falais, la belle-mère qui l’a accueilli quand il était enfant, le soustrayant, au moins pendant un certain temps, à la misère matérielle et morale de sa famille d’origine, et lui montrant, par sa simple existence, un autre monde, plein de promesses.
Bien qu’il n’eût été qu’un enfant, il avait deviné combien différente de sa mère était cette étrangère qui n’élevait jamais la voix, qui vivait au milieu de livres, de couleurs, d’objets qui lui paraissaient précieux…
Annie est pour Jean-Noël l’ambassadrice de multiples vertus : elle est belle et fascinante ; c’est une artiste ; elle est indépendante et courageuse – au point qu’elle a aimé et épousé un homme pauvre, Jean-Melchior Œtlinger, père de Jean-Noël, malgré l’opposition de sa riche famille, dont pendant des années, jusqu’à la mort de celui-ci, elle acceptera stoïquement d’être rejetée ou en tout cas séparée.
Pour le jeune homme, qui cherche à se construire une identité nouvelle et à se débarrasser du passé, la belle-mère n’incarne donc pas seulement la possibilité d’une revanche sur la pauvreté (d’ailleurs, Annie, au moins jusqu’à la mort de son père, ne possèdera plus rien à elle) et d’une ascension sociale, mais elle est aussi, sinon surtout, l’être qui peut lui faire franchir la ligne de démarcation entre la beauté et la laideur, entre la bassesse et l’esprit.
Quand, après la mort de son mari, Annie retourne vivre avec les siens, s’installe chez Jean-Noël la peur de la perte, peur qui se transforme en véritable hantise. Désormais, pour continuer à bénéficier de la proximité de la belle-mère il lui faudra en effet être admis dans son monde, ce monde des Villemur de Falais dont il voudrait voir les portes s’ouvrir toutes grandes devant lui et qui, au contraire, restent opiniâtrement entrouvertes, lui permettant de jeter un coup d’œil, mais pas d’entrer.
L’amour pour la belle-mère est sans aucun doute le pivot autour duquel tourne tout le roman.
Cependant, plus cet amour obsessionnel est dit et révélé, plus il s’imprègne de secret et de non-dit – peut-être seulement parce qu’il n’est pas totalement connu. Autour de lui un halo de mystère s’épaissit. Sur ce mystère, Bove ne projette heureusement jamais la lumière éblouissante d’un langage inquisiteur. Le grand écrivain qu’il est préfère garder le silence, ce silence qui dans l’écriture est aussi important, sinon plus, que ce qui est dit. Emmanuel Bove le sait, c’est seulement s’il est respecté que le mystère accepte de nous envoyer quelques-unes de ses lueurs ; si on l’interroge, il recule et se dérobe.
Et Annie ? Aime-t-elle son beau-fils ? Il semblerait que oui. Au fond, tout en se défendant contre sa demande absolutiste, on dirait qu’elle veut le protéger. Mais l’aime-t-elle en tant que Jean-Noël ou en tant que fils de Jean-Melchior ? Qui sait ! Peut-être les deux.
De toute façon, ici et là, même son amour pour le beau-fils a quelque chose d’indéfinissable et d’insaisissable.
Le thème de la misère, des vies marginalisées et exclues, est lui aussi récurrent dans l’œuvre de Bove, mais, dans Le Beau-fils, la façon dont Jean-Noël est tiraillé et ballotté entre l’évidence de son appartenance d’origine, obscure et malheureuse, et la société raffinée avec laquelle il est entré en contact grâce à la belle-mère, finit par générer de dramatiques courts-circuits et un enchevêtrement inextricable de sentiments, qui opprime et semble étrangler le personnage.
Avant tout il y a la honte, mot utilisé avec insistance dans les pages du livre. Jean-Noël a honte de la misère et de la vulgarité dans lesquelles il est né et a vécu son enfance, et le pire est qu’il ne semble pas destiné à pouvoir se débarrasser de cette honte : la misère et la vulgarité sont des fantômes obstinés et persécuteurs qui, à travers la mère et le frère − des êtres rejetés et querelleurs à qui la pauvreté a fait perdre toute décence −, étendent sur lui leur ombre menaçante et le harponnent.
Il a honte de son père, à la dignité douteuse et chancelante ; un père dont néanmoins il a été aimé et sur les traces duquel il semble destiné à marcher, comme sous l’effet d’une malédiction.
Mais il n’y a pas que la honte : il y a aussi la colère, ainsi qu’une pitié déchirante et, avec elle, un pénible sentiment de culpabilité pour avoir été d’une certaine manière privilégié, lui qui a passé une partie de sa vie avec sa belle-mère, à l’abri de ce monde-là.
C’est le sentiment de culpabilité qui le plonge dans une autre honte : la honte de sa propre honte.
En résumé, c’est l’horreur, l’horreur de ses origines, d’autant plus grande que ce carrousel de sentiments dévastateur se répète cycliquement.
L’horreur de ses propres origines a marqué au fer rouge le personnage et l’a rendu vulnérable à toutes les circonstances de la vie (la plupart du temps provoquées par lui-même), qui lui rappellent, même seulement en partie, le triste début de son existence, et font resurgir en lui la maudite honte. Jean-Noël aura honte de sa première femme et même, parfois, de la deuxième. Pour l’une et l’autre, il éprouvera par moments un peu de pitié. Par moments seulement. Parce que la tension envers la seule femme aimée, la belle-mère Annie, submerge tout et tout le monde.
Les trois femmes − Marguerite, Laure et Odile − qui croisent son existence ne comptent pas pour lui.
La première femme, la maîtresse, la seconde femme, au mieux servent son inaction : chacune d’elles, pendant un certain laps de temps, le soutient émotionnellement et économiquement, lui laissant le loisir de se livrer à l’attente névrotique d’une vie avec la belle-mère.
Le Beau-fils est, en effet, un admirable roman de l’attente. Jean-Noël attend. Il attend désespérément d’être accueilli sans réserve par Annie, il attend un signal, que se produise un événement qui lui donne cette confirmation − il ne doute pas que cela et cela seul pourra légitimer son existence, que cela seul pourrait l’amener à faire de grandes choses. L’attente le dévore de l’intérieur, le vide. S’il est exclu de la vie de sa belle-mère, il n’est rien, et il erre dans sa propre existence déprimé et ennuyé, accablé par une paresse dévastatrice, et, quand il agit, il agit de manière incohérente et inconsciente, allant de désastre en désastre. La longueur même du roman transmet ce sentiment d’attente et l’anxiété qui l’accompagne.
Je ne sais pas si Beckett, grand admirateur de Bove, a lu Le Beau-fils. En tout cas, je pense qu’il ne pouvait pas ne pas l’apprécier, du moins en tant que monument à l’inutilité de l’attente.
Le roman n’est pas toujours facile à lire. On y trouve ici et là des passages arides. Mais, dépassez-les, Bove ne manquera pas de vous étonner, grâce notamment à de splendides analogies ; les analogies, pièges extrêmement insidieux pour un écrivain, découlent de sa plume avec une précision et un bonheur vraiment impressionnants.
La manière dont Bove mène la narration − et pas seulement dans ce roman −, peut parfois elle aussi désorienter : je pense à sa fréquente tendance à retarder, à différer certains passages de l’histoire (nous arrivons souvent à connaître l’effet d’un événement avant l’événement lui-même) ; ou encore à son utilisation répétée d’ellipses, qui peut entraîner de véritables lacunes à l’intérieur de l’histoire, lacunes que le lecteur devra combler... Mais tout cela, nous le découvrons à mesure que nous le connaissons mieux, est un élément de fascination supplémentaire du “plus grand des auteurs français méconnus”. (11)
Luisa Stella
Notes
1. Entretien filmé de Jean Gaulmier avec Jean-Luc Bitton. Emmanuel Bove. La vie comme une ombre de Raymond Cousse et Jean-Luc Bitton, Le Castor Astral, Paris 1994, p. 226.
2. “Ce choix d’une littérature ‘du silence’, dangereux pour la notoriété, sera rarement partagé par ses pairs”. Ibid. , p.204.
3. Entre les autres, Christian Dotremont, Paul Morelle, Raymond Cousse, Jean-Luc Bitton e Peter Handke, qui a aussi traduit en allemand Mes amis, Armand e Bécon-les Bruyères.
4. L’éditeur Yves Rivière, Les éditions Flammarion…
5. Entretien de Philippe Soupault avec Raymond Cousse. Emmanuel Bove. La vie comme une ombre de Raymond Cousse et Jean-Luc Bitton, p. 96.
6. Ibid., p. 184.
7. Theodor Adorno, Minima moralia.
8. Entretien d’Emmanuel Bove avec André Rousseau pou Candide, février 1928. Emmanuel Bove. La vie comme une ombre de Raymond Cousse et Jean-Luc Bitton, p. 134.
9. Ibid., p. 255.
10. Ibid., p. 291.
11. Libération.
®